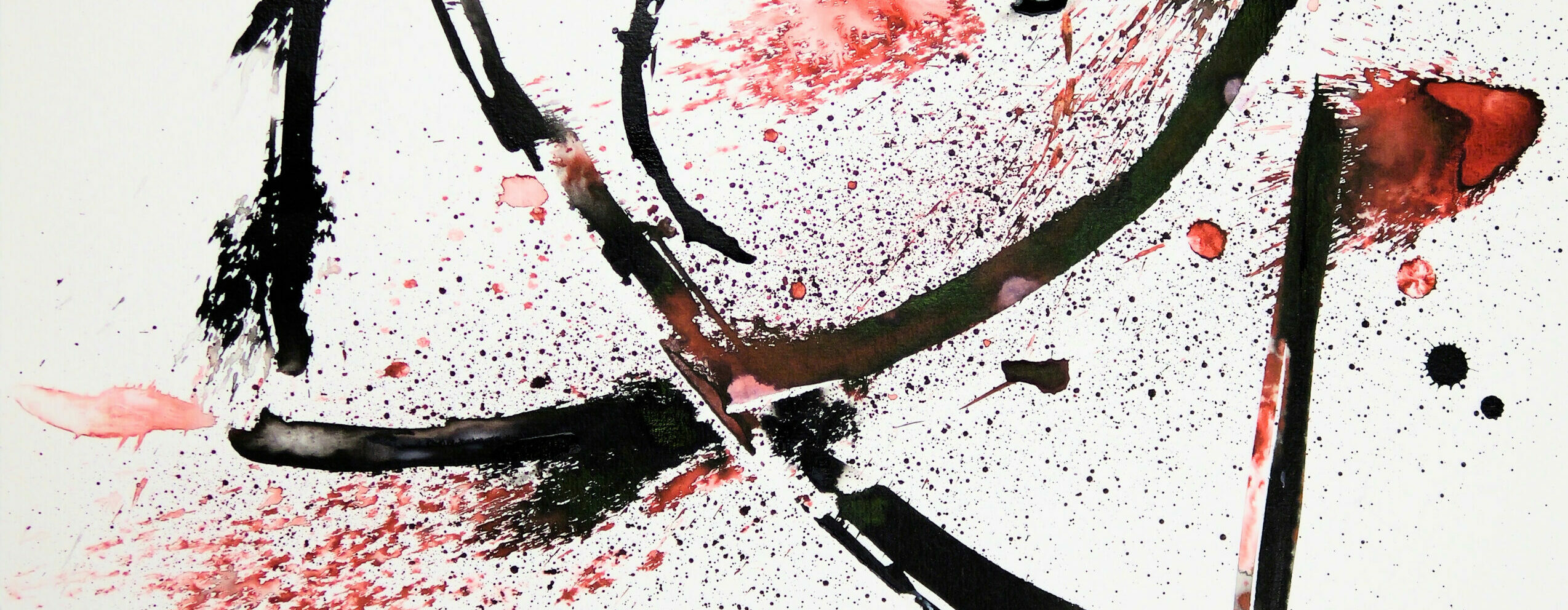J’ai choisi la ruelle. Je vis dans les sous-bois de votre ville. De là, j’observe les braises s’élever et cheminer dans votre forêt de bois mort. Déstabilisée par l’ignorance de votre propre anéantissement, je questionne votre réalité. Peut-être est-il mieux, pour vous, pour nous, que vous ne soyez qu’un rêve, une sombre débâcle de l’inconscient. Alors de mépris, de peine, de douleur, de dégoût, je me détourne. Et déjà vous êtes à mes talons, promptes à éviscérer quiconque vous laisse à votre propre fange. Vous m’entachez au sol et plus vite qu’une ombre je retourne dans le crépuscule de ma ruelle. Vous croyez m’y cantonner, mais voici mon royaume.
Tu ne parviens pas à visualiser ce qu’est la ruelle. C’est le paysage des rêves agités des nuits d’été. Toute matière est transformée par l’intime. Les escaliers tournoient comme des dentelles brinquebalantes. Les façades caillent, les briques ont la couleur de la rouille des rambardes. Une fenêtre est posée en travers, vaine tentative d’un rectangle se rêvant losange. Le sol est un vieux buvard de craie qui subit les tentatives successives d’égayer le bitume. Le ciel est bleu, l’air est doré, les arbres sont verts, la vieille voiture de collection stationnée dans la cour est coupée après la banquette avant. Le réseau électrique a développé son propre écosystème, le lierre l’assaille, les bûches alourdissent les câbles, oiseaux et écureuils s’entrecroisent sur ces autoroutes aériennes, slaloment entre les baskets suspendues. Les cosmos poussent entre les fissures des bacs en béton, les chats à grelots bougent le moins possible, agacés par leur propre bruit.
Plus tu te rapproche de la rue, plus les poubelles s’accumulent. J’aime à croire qu’elles dissuadent le tout-venant à entrer. Que le monceau d’ordures garde les portes de la précieuse domesticité de voisinage. La ruelle a le goût des luttes gagnées, du droit au privée, au pas de côté. À s’écarter de l’autorité, sans la défier mais sans se soumettre. À simplement refuser son droit sur sa vie.
J’ai pris la ruelle comme d’autres ont pris la mer. J’ai tout laissé sur le seuil, au dernier lampadaire. Mon nom, mon histoire, mes espoirs, mes envies. J’ai erré à la recherche de nouveaux désirs, j’ai cartographié venelles, squats, cours, passages, tunnels, et j’ai laissé des petits morceaux de moi partout. Parfois j’en retrouve au détour d’un trébuchement, je le palpe doucement pour voir s’il est toujours vivant. Souvent il est mort. Alors je le laisse là où il a passé ses derniers moments, seul, frigorifié et libre. J’ai si bien tourné dans ces ruelles que je me suis créé un dédale hors du temps, où je n’accepte que celles qui entrent en ayant la certitude d’être chez elles. Les autres resteront dans l’officiel, ceux dont les voix percent au matin les dernières joies de la nuit.
Elles peuplent mes déambulations d’odeurs, de musiques, de voix qui me guident parfois vers des réponses. Je me suis emmêlée dans de trop nombreuses pistes, je ne me suis pas perdue, mais je me suis rendue inatteignable. Dans une cour à l’abandon, envahie par une pelouse haute et des pissenlits blancs, il y a une chaise à bascule pourrie par les intempéries. Sur cette chaise, il y a un enfant qui me regarde passer. J’aime le tableau, mais pas trop l’enfant. Il sait qui je suis, celle qui hante sa périphérie, qui écoute la radio de sa mère tôt le matin, quand elle fume sa première cigarette avec un café noir. Celle que sa mère pourrait être, qui couve juste là, dans ce moment où les autres dorment encore. Je suis le possible du foyer qui s’effrite. Mais il est trop tard pour me menacer gamin, la hiérarchie familiale te rappelle à l’ordre et moi je vais continuer à rôder, à vouloir détruire ce qui te rassure car c’est ce qui nous détruit toutes. C’est pour ça que je suis partie, c’est pour ça qu’on me chasse, c’est pour ça que j’ai peur et que je terrifie. Je mourrai seule, mais invaincue.
Lorsque je deviens aigre immédiatement la ruelle me radoucit. Le visage indésirable est vite effacé par l’image furtive d’une main agrippant une fesse derrière une voiture. La douceur sauvage de celles qui cèdent à leurs désirs me submerge, me rend à la vie, lavée et haletante. Alors la lune sort de l’ombre, toutes ses étoiles avec elle, mon heure est de nouveau là. Les frontières se brouillent, nous gagnons encore du terrain. Les terrasses s’embrasent de nos rires et vous rentrez vos filles, vous calfeutrez toutes celles qui ne résisteront pas à notre appel.