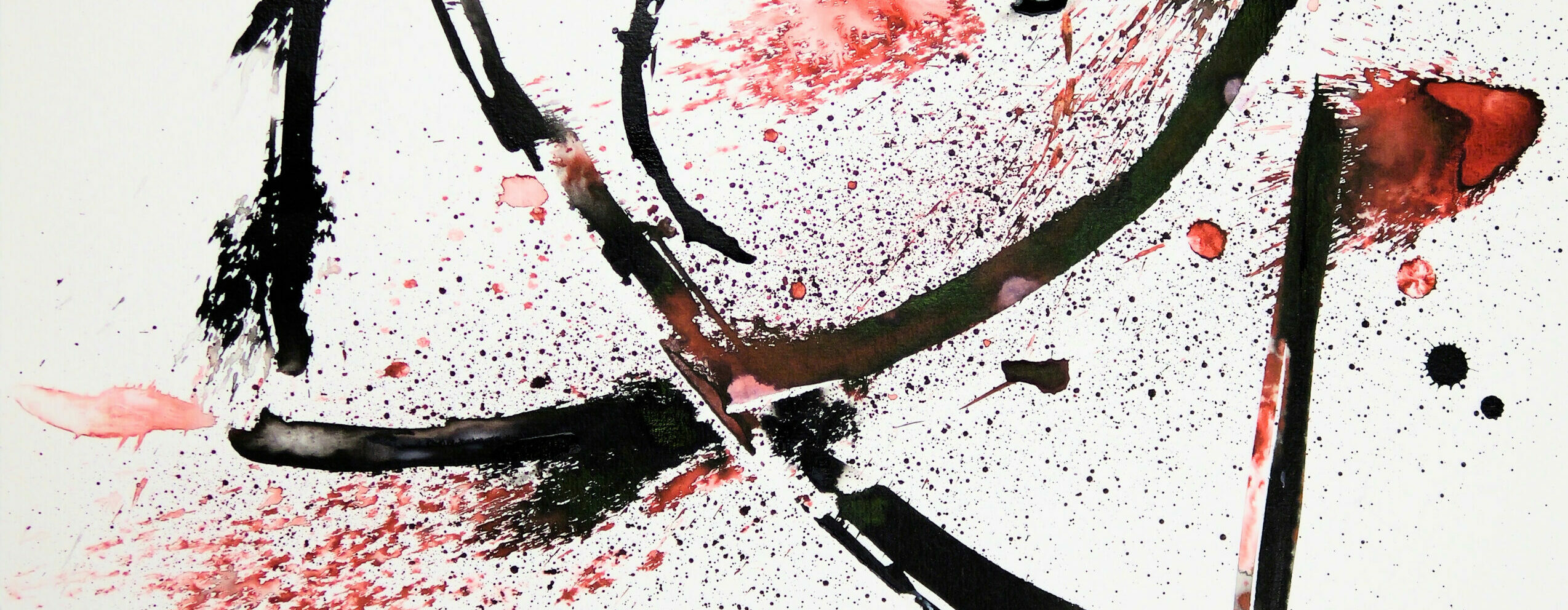À Maria G.-T.
Il n’y a pas eu de choix conscient, il y a eu qu’une force qui m’a portée hors de toi. J’ai détesté cette force : elle m’a déchirée de l’intérieur, elle a brisé tout ce qui était solide et m’a délestée du poids de liens merveilleux qui m’habitaient profondément sans que je le sache. J’ai ignoré leurs racines et me suis retrouvée arrachée comme une mauvaise herbe. Sans ce poids, j’étais légère comme une plume et mon moi s’est envolé aux grés de la violence des temps. À la fin, il n’en restait plus rien et j’étais devenue une coquille de potentialités, un coquillage mort : une carcasse.
Je suis partie un beau matin de septembre. On n’entendait plus les étourneaux depuis le mois de juillet, mais je les imaginais tourner dans le ciel et leurs chants m’accompagnaient. J’ai pris des affaires et je les ai enfournées dans une très grosse valise rouge qui prenait la poussière dans un coin de notre appartement. Là-bas, je voulais recommencer, franchir une nouvelle étape et m’extraire avec bonheur des cordes qui enserraient mes pensées et mes émotions. A la gare principale, d’énormes engins lancinaient des sillons et des fosses pour tout rebâtir, soulevant des mottes de terre et de goudron aussi lourdes que mon cœur. Leurs rythmes éreintants creusaient entre mes tempes de larges allées tout en me poussant en avant.
J’ai traversé toutes les rues qui m’attendaient avec une appréhension grandissante, avec dans le cœur et le corps une angoisse si grande qu’il aurait suffi d’un battement de cil pour qu’elle m’anéantisse totalement. Les rues étaient arides, ocres et oranges, inondées de soleil et de poudre urbaine brillante qui crissait sous mes pas. Je cherchais dans les bars, les restaurants et les boutiques des visages par avance familiers, des sourires ami·es et des yeux attentifs. Les feuilles des arbres étaient presque jaunes de canicule, et on entendait des cigales au coin des places : c’était comme partir habiter au bord d’un lieu de vacances, au bord d’un précipice. C’était un entre-deux merveilleux, profond, rempli de promesses et d’imaginaires lumineux.
Comment ne pas choisir de me retrouver ici ? Entre notre chemin bleu et gris, humide de larmes, de pluie et d’autres liquides poisseux, et cet autre endroit, irisé et gorgé d’histoires, qui aurait choisi le premier ? Pas moi en tout cas.
J’avais dans la tête des centaines de mots, emboîtés dans une joie contagieuse, qui formaient un maillage serré et magnifique. J’avais dans le cœur des projections infinies de rires, de paroles et de découvertes. Je voulais absolument poursuivre mon propre désir, hors de toi, hors de nous, loin de tes mains et tes yeux avides, loin de ton froncement de sourcil inquiet et contrarié lorsque nous ne faisions plus l’amour. Je voulais découvrir et explorer mon désir pour les autres femmes et croire qu’un recommencement était possible, qu’était venu en somme le temps de tout réinventer. Je voulais aussi lire tout ce qu’il y avait à lire sur le sujet, comprendre tout ce qui pouvait être compris, participer à cette large discussion exaltée qui éclatait par remous successifs depuis plusieurs décennies, m’inscrire dans ce temps long et graver quelque chose de moi dans ce tissu fait de pensées, de paroles, de colère et de joies furieuses.
J’aimerais pouvoir dire les effondrements et les déceptions, mais les mots refusent d’affleurer au-delà de la surface de mes murmures intérieures, presque inaudibles. Aujourd’hui encore, tous les désirs sont coincés en-dessous. Ils n’ont jamais franchi la frontière du réel : ni celle de ma conscience pleine, ni celle de mon courage.
J’aimerais pouvoir raconter tout ce qui s’est passé ensuite, mais mon récit refuse de se former. Repliant le tissu des évènements brouillard, je reste ici, les mains ouvertes de poussière. Je me rappelle tout de même qu’il y a eu des printemps d’espoir et des printemps d’enfermement ; je sais que la clôture intérieure était bien pire que l’entrave de nos mouvements, cette année-là. Les eaux du Rhône coulaient avec force et nous avons regardé leur flot aveugle et décidé, tandis que nous tournions nous-mêmes autour du pot et alors que les voitures s’étaient enfin tues. Ce printemps-là, nous nous retrouvions en secret en fabriquant de faux papiers, nous fumions des cigarettes assises par terre, jetant des coups d’œil anxieux et tendant l’oreille afin de guetter le son de policiers qui nous auraient jetées à l’intérieur de nous-mêmes sans autre forme de procès. Nous avons marché jusqu’à un banc qui faisait parfaitement face à la réunion entre les deux fleuves et nous avons observé leur confluence intraduisible. Autour de nous, la végétation voulait nous faire croire qu’elle était sauvage et que nous nous étions perdues dans une jungle nouvelle : certaines ronces se faufilaient sous nos pieds et entre les racines des arbres, d’autres grimpaient sur les bords de la rive, ignorantes de nos envies, aveugles à notre point de vue. Derrière nous, des passant·es répétaient leurs gestes et leurs promenades jusqu’à la nausée, mais nous nous étions dissimulées loin d’elleux. Nous avons dit : à partir d’ici, tout ce qui nous arrivera sera poussière. Je savais que tu allais partir loin et que ma solitude me dévorerait les entrailles chaque jour, sans répit. J’avais envie de te prendre dans mes bras, mais j’étais infiniment plus à l’aise avec notre distance : le bloc de béton qui nous reliait me semblait si confortable et si tranquille que je ne l’aurais déplacé pour rien au monde. Il m’enserrait et me calmait. Je ne me rappelle pas vraiment les mots que nous avons partagés ce jour-là, simplement que nous cherchions désespérément à imaginer la suite, car tout ce qui précédait semblait avoir été rayé en quelques semaines de cet état d’exception. Nous voulions deviner ce qui pouvait nous attendre, anxieuse de savoir ce à quoi nous pouvions prétendre, ce qui nous était finalement « permis d’espérer », et, pour ma part, incapable de parier sur mes propres forces. Je me rappelle particulièrement le vert des feuilles de ce printemps-là, probablement parce que c’était le seul spectacle que j’avais le droit de contempler : un vert intensément clair et tendre qui éclipsait entièrement mes songes, l’espace de quelques secondes, et m’enveloppait de la douceur dont j’avais cruellement besoin. Je pouvais parcourir mon kilomètre sous de ce vert, aller et retour, sachant qu’il était là, tout en m’enfonçant chaque jour davantage dans mon propre gouffre. Quand tu es partie complètement, j’ai décidé que j’ignorerais ma douleur : je l’ai rangée soigneusement dans une boîte que je n’ai plus jamais ouverte. Aujourd’hui encore, lorsque nous nous parlons, la boîte demeure bien hermétique, et je la chéris.
Un jour, nous nous sommes réunies entre femmes bisexuelles et nous avons dit : il n’y a pas d’imaginaires, il n’y a pas de représentations, et il n’y a pas non plus de communauté. Il y a à peine un mot, car il est déjà entaché de doutes, de railleries et de critiques acerbes. Il n’y a que des espoirs contrariés et des mains bouleversées qui cherchent désespérément un point d’ancrage. Il n’y a pas de soutien, il n’y a pas de récit, pas de questions ouvertes amenant la profondeur de nos expériences, de nos conflits intérieurs et de notre impossibilité à simplement dire : je suis ceci et je suis cela. Je suis déchirée entre toi et les autres, entre mon passé et mon futur avorté, entre tes yeux si doux tes mains pleines d’amours malgré ta violence, et l’inconnu total qui nous habite et nous étreint. Nous nous sommes regardées et nous avons dit : je suis perdue, j’ai peur. Je crains le regard des autres femmes, j’ai peur de mon propre regard comme de celui des hommes, j’ai peur de ne pas trouver ma place dans ce maillage. Je ne suis pas plus que les mots, je ne suis pas plus complexe ou plus subtile que les théories féministes et les idées politiques : au contraire, je suis bien moins. Je suis en deçà, bien en-dessous, bien plus rudimentaire : je suis la trace odieuse des restes de nos terreurs. La conscience de mon désir refuse de transparaître, elle reste bloquée à l’intersection, immobilisée face à cette bifurcation. Que faut-il faire ici ? me demande-t-elle avec ses yeux d’enfant.
Nous avons dit « je suis bloquée et j’ai peur » et l’écho de nos émotions fragiles et ridicules à nos propres yeux nous a détruit.
Un jour, dans les paroles d’une femme au milieu d’autres femmes, j’ai vu mes mains et ma bouche qui voulaient s’approcher et dire, partager, ressembler et rassembler, se fondre en nous-mêmes. Mais la cigarette qui se consumait rapidement entre ses mains s’est écrasée et je suis restée en retrait. J’ai pensé « Ne fais pas de mal, ne l’approche pas ». La peur du rejet, autant que celle de nous heurter nous, nos corps et nous-mêmes, m’habite bien plus profondément encore que mon propre désir. Cette peur me définit bien en-deçà des catégories et des lettres majuscules. Un autre jour, un regard a traversé le mien avec une intensité violente de désir, et nous nous sommes assises longtemps sur les marches de pierre glacées des pentes, nous avons attendu dans cette nuit brisée du mois de mars, mais tu n’as rien fait et moi non plus et nous étions ivres et je craignais chacun de mes gestes et chacun de mes désirs. Le froid nous étreignait très violemment alors nous sommes parties. Je n’ai rien fait. Et tu as marché jusque chez toi, tu avais trop bu alors j’aurais voulu te suivre, à distance, pour m’assurer que tu resterais saine et sauve, prête à écarter de ta route tous les obstacles. Deux escaliers se faisaient face et, bien que nous parvenions dans ce lieu à partir de l’un d’entre eux, nous aurions aussi bien pu emprunter l’autre. Nous avons tourné le dos à cette bifurcation manquée, nous n’avons rien pu faire d’autre que de la laisser là.
Aujourd’hui encore, je me tiens face à elle, j’attends. Je continue à lire et à chercher. J’espère comprendre bientôt comment la franchir, j’espère savoir quelle route emprunter. Je me tiens là, figée, frigorifiée par les voix des autres et enserrée dans mon corps. Je gratte la poudre au sol de ces chemins avec la pointe de ma chaussure, je creuse tout doucement et timidement, mais ce bruit pathétique qui résonne en moi amène les regards inquisiteurs et désapprobateurs de tous les oiseaux qui ont le malheur de croiser ma route. Nous avons parfois dit « Ce sont des oiseaux de malheur » mais nous n’y croyions pas et nous ne voulions surtout pas ébrécher le calice de la sororité. Certaine s’y sont risquées et elles ont charriées avec elles une colère obtuse d’enfant blessé. Nous avons dégagé un étroit passage au milieu des routes, nous nous y tenons et nous campons ici, pathétiques à nos propres yeux, terrifiées par notre propre audace à demeurer immobiles.
En remontant la confluence, j’ai vu les deux embranchements
Je ne pouvais pas choisir, la force des eaux m’en empêchait
Elle me contraignait sans cesse à les regarder ensemble, en un seul et même regard
J’ai lutté j’ai vidé mon souffle j’ai épuisé mes forces
Pour remonter l’un des deux fleuves
Aucun ne m’a accueilli
Et je me trouve là, à l’intersection, empêchée
Affligée